Une aube hésitante de février –1934- s’est levée sur la ville. Là-bas, au-delà de l’Amirauté, c’est un ciel allègre, un horizon marin dépouillé. Mais de lourdes nuées traînent sur la haute ville, mal contenues par le dôme de la Médersa et les bâtisses neuves dont la Casbah est bordée. On les devine gorgées d’eau comme une éponge. Leur suie contraste avec la blancheur des murailles, donnant à tout ce plâtre un éclat livide. Et les yeux, d’instinct, laissent ce décor blafard pour chercher sur la mer des couleurs familières. C’est l’heure où le pas des ouvriers sonne plus clair sur le trottoir. Place du Lycée, les yaouleds crient l’Echo, la Dépêche et la Presse, la chéchia enfoncée jusqu’aux yeux et les pieds nus raidis de froid. Un tram grince, et l’autobus bleu tendre s’élance vers le Frais-Vallon.
Sept heures. L’armée des balayeurs part à la conquête d’Alger. Voici les poubelles montées sur roues, chères au gouverneur Lutaud, piquées chacune d’un balai, superbe comme un étendard. Ce noir, qui pousse la sienne avec tant de dignité, on l’imagine, masque camus, torse musculeux, prosterné aux pieds d’un empereur romain ou debout dans l’arène des gladiateurs. A son bras, la plaque de cuivre du service vicinal devient un trophée.
Sept heures et demie. Mon ami Joseph boit sa première anisette.
Je prends alors la rue Sidi-Abderrahmane-el-Salhi, que plus communément on nomme escalier Marengo. A gauche, les murs du lycée ; à droite, la grille du jardin. « Il est défendu, sous peine d’amende, de jouer au ballon dans cet escalier », annonce par deux fois un écriteau municipal. C’est pourquoi, sans doute, en attendant l’heure de la classe, ces gamins s’acharnent après une maigre pelote. Tout en haut des marches, un bec de gaz en forme de croix se découpe sur le ciel gris. Deux ouvriers, les mains aux poches, la casquette narquoise, grimpent à grandes enjambées. Trois filles en cheveux, qui descendent bras dessus, bras dessous, les frôlent au passage. Ils se retournent, elles rient, mais un coup de vent disperse leur rire et franchit la grille pour agiter toutes .les palmes du jardin. Les larges feuilles des bananiers ont ployé sous les averses nocturnes. Des débris de pots cassés s’enfoncent dans l’humus et, de toute cette végétation matinale, se dégage une odeur humide, une vapeur mouillée. On aurait presque le cœur serré si, là, parmi la verdure, n’éclataient point les taches dorées des oranges, des oranges rondes, menues, naïves, comme dans une miniature de Racim. Il semble qu’il suffirait de tendre la main pour les cueillir. Ne doit-il pas les regarder, comme les fruits d’un paradis si proche à la fois et si lointain, l’éternel meskine qui psalmodie sa complainte à la porte de la mosquée ? En face de lui, un taleb enturbanné, assis à la turque sur une mince natte, des lunettes d’acier sur un nez bourgeonnant, lit son Coran en dodelinant de la tête. A portée de la main, le simple attirail des écrivains publies : deux encriers, du papier et des plumes. Une lettre finie, il plonge dans sa lecture sacrée.
Rampe Valée, ce sont toujours des gosses qui trottent vers l’école, cartable sous le bras. Mais leurs cris agitent peu le carrefour, encore mal éveillé sous le ciel menaçant. Un Arabe traverse, tangue nonchalamment sur ses jambes maigres, et mord dans un large beignet, tout dégoulinant d’huile grasse et de miel. Le parfum du pissoir inondé encense les affiches du Bijou-Cinéma. Le long de la mosquée, des formes immuables, accroupies en tas, et qu’on retrouvera, des heures après, dans la même posture, au même endroit. Déjà, deux petites mendiantes haillonneuses se collent au passant, comme de mauvaises mouches, répétant avec obstination : « Don’ moi un sou… Don’ moi un sou… Don’ moi un sou !… » A la porte de la mosquée, un vieux regarde l’effigie du paquebot Madonna, qui vient de partir vers la Mecque, et reste là, figé dans son burnous et dans sa méditation. Le dôme de la Médersa est rond comme une mamelle. Ici s’ouvrent les escaliers de la Casbah. Mais pourquoi ces marches achoppées, ravinées, visqueuses, où la pluie a creusé des trous pareils à des chancres, pourquoi les a.-t-on baptisées « Boulevard de Verdun » ? Ce n’est pas là le moindre mystère de la Casbah d’Alger. Des Sénégalais descendent prudemment, se gardant de déraper sur leurs grosses semelles douteuses. Une vieille monte, ses pieds lourds d’œdème à l’étroit dans les souliers tordus, se hisse ‘péniblement, ahane, rajuste son voile. Comme elle, je m’arrêterai à chaque plate-forme, et ce sera pour regarder Bab-el-Oued et la mer. Voici le Lycée à vol d’oiseau, avec ses terrasses pavées de rouge, l’avancée du quartier Nelson, et l’enseigne du Majestic, soleil candide hérissé de rayons, comme ceux que les enfants tracent sur leurs cahiers. Là-bas, des vagues se gonflent, courent vers les rochers de Saint-Eugène, brisent leur écume. L’horizon s’est gâté et des brumes blanchâtres gagnent Notre-Dame d’Afrique et les coteaux de la Bouzaréa.
http://lesamisdalgerianie.unblog.fr...]
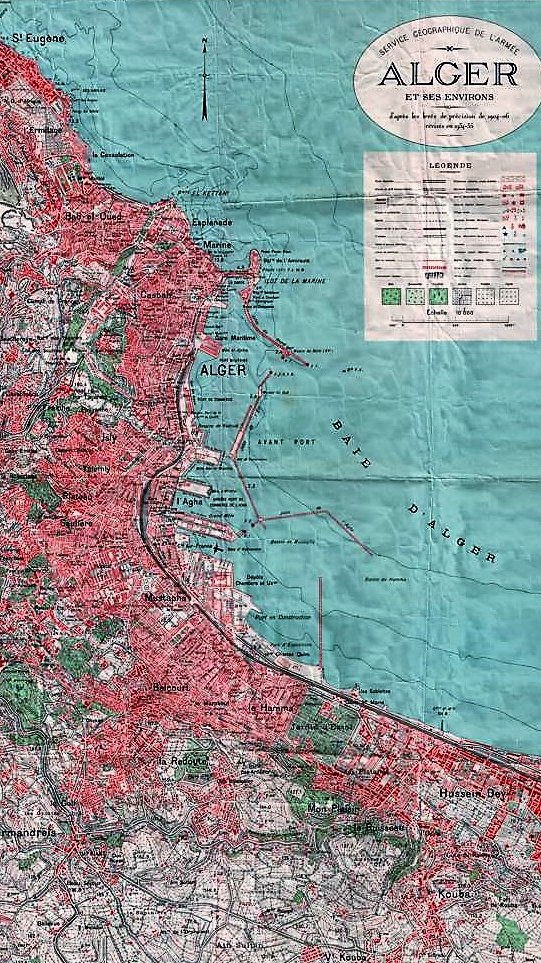
ALGER 1934
Ici, les immeubles de la Croix-Rouge attendent l’heure des consultations habituelles. Des femmes sont là, par groupes, debout, assises sur les marchés, ou quelque pâle enfant accroché à leur dos. Quelles misères, sous ces haïks bien ajustés ? Une fillette contemple ses pieds soigneusement teints de henné, mais dont le talon n’est qu’une plaie. Tout à l’heure, elle repartira, faisant claquer dans l’escalier ses socques de bois, avec un pansement bien propre. Et quelle rue, quelle tanière absorbera son doux visage un peu grave, ses cheveux bien séparés par deux raies perpendiculaires, sa petite tresse dans le dos, raide comme une momie, et son sarouel de velours rose ?
Tout là-haut, le campement des gitanes est silencieux, abandonné. On cherche la magnifique pouillerie en plein air, les jeux des gosses demi-nus, l’opulence échevelée des matrones, l’éclat des jurons espagnols. Peut-être, toute la tribu s’est-elle serrée frileusement sous cette tente, dont une étrange auto, jaune et noire, défend l’entrée. Mais devant l’école franco-arabe, c’est une bousculade de chéchias criardes autour de la plaque, de zinc du marchand de calentita.
Je laisserai la triste Prison Civile pour emprunter le chemin d’El-Kettar. Face aux terrains militaires, des badauds se sont attroupés, et je m’approche. C’est un manège en plein vent, une simple piste, où un sous-officier fait tourner un cheval au dressage. Chômeurs invétérés, vagabonds sans pain et sans gîte, que le refuge voisin a sans doute abrités cette nuit, ils sont tous là, mangeant des yeux, sans dire un mot, la belle bête, crinière volante, qui trotte, s’arrête, repart, soumise à la voix et au fouet. Je songe à l’instinct qui a immobilisé tous ces miséreux en extase devant ce cheval, devant le cheval, antique orgueil de leur race. Et soudain, une fanfare éclate ; dissimulé derrière les eucalyptus, un orchestre militaire répète, arrachant à tous ses cuivres un air désolant de musique foraine, qui s’étire sous le ciel bas et m’emplit le cœur d’un sourd désespoir. Je chasse avec peine l’image d’une fête de village, en France, dans la boue. Mais des pigeons tournent dans le ciel, et le marteau du ciseleur arabe, devant le cimetière, frappe les stèles de marbre, blanc. Une passerelle franchit la brèche des fortifications, si légère qu’on l’imagine s’effondrant. Un homme passe, tenant deux chiens en laisse. Et comme j’ai suivi le mur du cimetière, Bab-el-Oued, tout d’un coup, a surgi sous mes yeux. Un fragile arc-en-ciel, né là-haut des casernes, de l’acropole du dey Hussein, perd vers la Cantera une arche impalpable. Comme je cherche à la saisir, parmi la masse des maisons, une pluie fine et froide se met à tomber, qui m’oblige à fuir. Mais je me retourne encore, et le faubourg, une dernière fois, me tend son visage, tout mêlé de larmes et de soleil.
Louis LATAILLADE.

 NotreJournal
NotreJournal

